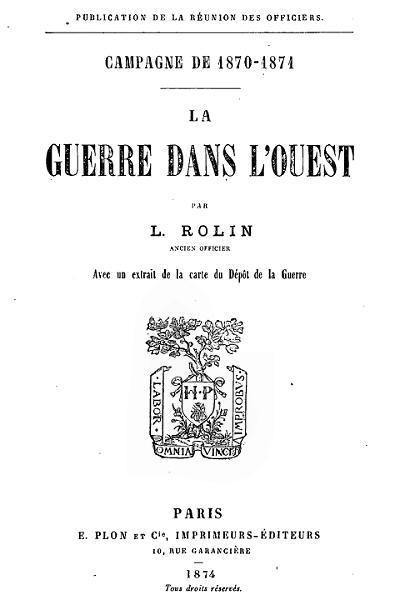Documents

La guerre dans l'ouest : campagne de 1870-1871
| . | Chapitre 1 |
Marche des Allemands sur Paris
Source : L. Rolin.


.

 Situation militaire de la France au mois de septembre
Situation militaire de la France au mois de septembre
Après que l'Empire eut succombé à Sedan, nos armées régulières, battues dans dix combats,
étaient détruites, cernées ou captives, et la France se trouvait dans la plus effroyable
situation qui eût jamais attristé son histoire : restée seule, sans armes et
sans gouvernement, elle n'avait plus que la terrible responsabilité d'une
campagne mal engagée et
plus que compromise.
Cependant, le sentiment qui se manifesta chez elle après ces premiers
désastres ne fut point celui du découragement ou de la peur, mais plutôt celui de
la colère et de la vengeance.
Au lieu de renoncer à la lutte après un mois d'hostilités,
la France retrempa son courage dans son infortune et relevant son drapeau, elle
appela chacun de ses enfants à la défense de l'honneur national.
Commentant la
célèbre proclamation de Saint-Avold, les journaux officieux du roi Guillaume
avaient donné à entendre que ce n'était pas à la nation française, mais à
Napoléon III, que l'Allemagne faisait la guerre;
ils avaient nettement
séparé l'Empereur de la France, et l'Empereur étant hors de cause, on était
fondé à croire qu'il serait facile de désintéresser le vainqueur.
Notre ministre
des affaires étrangères, M. Jules Favre, se trouvait sans doute sous le coup
de
cette illusion lorsqu'il se rendit de son propre mouvement à la conférence
de Ferrières;
mais il put s'assurer là du degré de confiance que méritaient les
déclarations germaniques,
et en quittant le chancelier allemand, il vit bien qu'il n'y avait
plus qu'à combattre.
Pour les Prussiens, il n'y avait pas de paix possible sans la cession de
notre frontière
de l'Est, et sans le payement d'une rançon qui devait consommer notre ruine;
en outre,
c'était à Paris même, dont la route leur était ouverte, qu'ils voulaient dicter leurs
conditions.
Paris était depuis longtemps leur objectif; c'est là qu'ils voulaient
assouvir les haines accumulées contre nous depuis un demi-siècle.
La capitulation de Sedan fut signée au château de Bellevue, le 2 septembre,
à onze heures et demie du matin à midi, les armées allemandes recevaient
l'ordre de faire leurs préparatifs pour continuer leur marche sur Paris.
Elles se mettent en route le 4, atteignent Dormans le 8, s'emparent de Laon
qu'elles enlèvent au passage le 9, et s'avancent désormais sans rencontrer
d'obstacles;
le 14, le grand quartier général prussien est à Château-Thierry, le
15 il est à Meaux.
Chaque jour les télégraphes et les chemins de fer, ces organes
de la volonté et de la vie nationales, sont coupés ou détruits; chaque jour de
nouvelles régions se voient isolées de la capitale ; c'est comme une lente paralysie
qui commence, et les membres,
isolés du cerveau d'où partait l'impulsion, vont maintenant se débattre
dans une terrible agonie.
Le 17, les Allemands marchent sur Pontoise et sur
Corbeil leur ligne se resserre de jour en jour, d'heure en heure le 18, ils
sont à Poissy; le 19, à Versailles, et leur cercle d'investissement, peu à peu
rétréci, est tout à coup fermé brusquement.
Paris se voit désormais complètement
isolé de la province, et la France est comme décapitée.
En marchant si aventureusement sur notre capitale, les Prussiens cédaient
à des considérations politiques plutôt qu'à des raisons militaires il aurait
été possible de déjouer leurs calculs, en imitant de sages et illustres exemples.
Il fallait transporter ailleurs le siège du gouvernement et faire sortir de Paris
les bouches inutiles; de cette façon on eût enlevé à l'ennemi les deux
auxiliaires sur lesquels il comptait le plus, la sédition et la famine;
il était réduit à faire un siège régulier, opération dans laquelle il est
loin d'exceller, ou à attendre au moyen d'un investissement ce que, dans
son langage recherché, il appela le moment psychologique du bombardement.
Quant à la France, au lieu de dépendre d'une ville bloquée avec laquelle
elle ne communique plus qu'à de rares intervalles et par les airs; au lieu
d'attendre des ordres d'un gouvernement prisonnier des Prussiens et qui ne
peut plus songer qu'à lui-même, elle eût eu plus de facilités pour délivrer
sa capitale.
En un mot, on pouvait laisser entre les mains des Allemands
une simple place de guerre; on leur permit d'étreindre le cœur même du pays.
A l'approche de l'ennemi, le gouvernement de la défense nationale avait enfermé dans
Paris les derniers débris de nos armées régulières, quelques troupes de ligne dont
le corps du général Vinoy formait le noyau, des marins, et tout ce qu'il avait pu réunir
de bataillons de mobiles; malheureusement il s'y était enfermé lui-même, et, pour
organiser la défense en province, il s'était contenté d'envoyer à Tours une délégation
composée de trois personnes MM. Crémieux, Glais-Bizoin et le vice-amiral Fourichon.
Ce dernier avait seul une compétence militaire; les deux premiers avaient fait partie
de l'opposition sous l'Empire, et ils avaient énergiquement revendiqué nos libertés;
mais ils avaient combattu avec non moins d'énergie la loi militaire de 1868, et s'étaient
ainsi rendus les complices de ceux qu'ils accusaient.
Étrange et triste contradiction des choses: ceux qui étaient chargés d'organiser la levée
en masse, de prêcher la guerre à outrance et de décréter la victoire, étaient les mêmes
hommes qui, deux ans auparavant, avaient demandé la suppression de l'armée et l'abolition
de nos institutions militaires.
La tache de ces organisateurs était devenue bien difficile.
Pour porter l'armée du Rhin à la frontière et pour former ensuite l'armée de Sedan,
nous avions épuisé toutes nos ressources militaires.
Triste et incroyable situation! Avec neuf contingents, une population de 38 millions
d'habitants et un budget de la guerre d'un demi-milliard, il ne nous reste plus rien,
après un mois de lutte, ni cadres, ni soldats, ni matériel, et, pour défendre son propre sol,
la France est réduite aux derniers expédients.

 Troupes de marche de la ligne
Troupes de marche de la ligne
Nos réserves elles-mêmes sont déjà engagées, et plusieurs de nos
régiments de marche
ont été faits prisonniers à Sedan.
Pour en former d'autres, il va falloir organiser les quatrièmes bataillons des dépôts, or
ces bataillons sont composés des hommes de la seconde portion du contingent, c'est-à-dire
de jeunes soldats n'ayant que quelques mois de présence sous les drapeaux, et, par conséquent,
qu'une instruction militaire superficielle.
Un décret appelle les célibataires et les veufs sans enfants de vingt-cinq à trente-cinq ans
qui ont accompli leur temps de service;
leurs rangs reçoivent quelques débris échappés à nos premiers désastres; plus tard, à la fin
de septembre, on y ajoutera les jeunes recrues de la classe de 1870, et ce sont ces
bataillons de marche formés à la hâte, avec un nombre insuffisant de sous-officiers,
avec des officiers comptables ou de toute provenance, la plupart fatigués ou même usés
par le service, n'attendant plus que leur retraite, et ayant permuté deux mois auparavant
pour rester dans les dépôts; ce sont ces bataillons qui formeront nos troupes dites
régulières et nos têtes de colonnes.

 Garde mobile
Garde mobile
Avec ces troupes de marche en formation, nous avions
la garde mobile
qui devait primitivement faire le service de garnison et rendre toute
l'armée active disponible en permettant la mobilisation des dépôts.
Le plan adopté par Napoléon Ier en 1815, à son retour de l'île d'Elbe, était tout
le secret de la loi militaire de 1868.
Malheureusement l'organisation de la garde mobile, d'abord poussée avec activité par
le regretté maréchal Niel, fut arrêtée par son successeur.
Par suite du mauvais vouloir qu'elle avait rencontré de toutes parts, la loi de 1868
était donc une loi manquée.
La disposition qui portait que la garde mobile ne pourrait être exercée plus de quinze
jours par an, et que chaque exercice ne devrait pas
donner lieu à un déplacement de plus de vingt-quatre heures,
supprimait par cela même les moyens d'en faire une force sérieuse.
Bientôt le gouvernement, l'ayant expérimentée à Paris, ne vit plus dans l'institution
qu'un sujet de crainte; il forma d'abord le projet d'envoyer les hommes faire
l'exercice aux chefs-lieux de canton avec des armes placées sous la protection
de la gendarmerie, mais cette idée ne fut même pas mise à exécution quand l'ennemi
parut, les gardes mobiles n'avaient pas encore de fusils et ne pouvaient opposer
à l'invasion que le seul obstacle de leurs poitrines.
Cette milice, qu'on se plaisait à comparer à la landwehr, à la nation armée,
était bien la nation elle-même, et ce fut un spectacle mémorable que cette application,
au milieu de nos revers, du service militaire obligatoire.
Cette égalité devant
le danger n'était point une chimère; la plus étroite solidarité avait confondu
sous le drapeau, dans un même sentiment, toutes les conditions et toutes les
fortunes.
La garde mobile, c'était la jeunesse française dans toute la richesse
et dans toute la variété de ses éléments on ne l'avait point appauvrie pour
former les armes spéciales ou les corps d'élite;
les jeunes gens remplacés auparavant
payaient comme les autres leur dette à la patrie, et bon nombre d'engagés volontaires
venaient grossir les rangs et prendre leur part au péril commun.
C'était un
admirable recrutement, comprenant des jeunes gens de vingt et un à vingt-six ans,
tous dans la force de l'âge, et bien supérieurs aux recrues de la ligne;
non seulement par leur constitution physique, mais encore par leur intelligence
et par leur instruction.
Aussi la supériorité des bataillons de marche sur ceux de la
la garde mobile consistait surtout dans l'armement.
La ligne avait des fusils
Chassepot ,
et la meilleure arme des mobiles était le
fusil à tabatière .
L'habillement était des plus défectueux, et nos braves jeunes gens se rappelleront
longtemps leur premier uniforme, pour lequel l'État leur avait alloué la somme de
dix francs, et qui se composait d'une simple casquette et d'une blouse de toile bleue.
L'équipement consistait dans une mauvaise musette ou un bissac grossièrement cousu
plusieurs mobiles portaient même leurs effets serrés dans un mouchoir,
et auraient plutôt ressemblé à des émigrants qu'à des soldats, si deux galons
de laine rouge, ajustés sur leurs manches, n'eussent distingué ces nouveaux croisés
de l'indépendance nationale.
Si le choix de ses officiers avait été partout dicté par des considérations
essentiellement militaires; si elle avait, été réunie et exercée, la garde mobile
aurait encore rendu de meilleurs services; mais quand après nos premiers revers
elle fut appelée par décret à l'activité, elle passa subitement, sans transition,
de l'oubli auquel on l'avait vouée à la vie active des camps et des champs
de bataille.
On ne peut se rappeler sans émotion les tristes circonstances dans lesquelles
elle parut pour la première fois en rase campagne.
En s'avançant de Metz sur Paris
, les Allemands rencontrèrent, le 25 août,
à Sivry-sur-Ante ,
un millier de gardes mobiles du 4e bataillon de la Marne
qui, à l'approche de l'ennemi, avaient été dirigés de Vitry sur Sainte-Menehould .
"Après leur avoir envoyé quelques obus", dit le colonel fédéral Rustow, "une fraction
de la 6e division de cavalerie les chargea, les dispersa, et les fit en grande
partie prisonniers; un grand nombre furent sabrés ou tués à coups de lance.
Les Allemands ont prétendu que ces gardes mobiles avaient voulu se rendre;
mais que ne sachant par quels signes conventionnels manifester ce dessein,
ils s'étaient arrêtés et avaient formé le carré de leur mieux.
C'est là ce qui avait été la cause de la charge inutile des cavaliers."
L'écrivain que nous venons de citer paraît n'avoir connu que le premier acte d'un
drame dont voici le lamentable dénoûment : faits prisonniers, désarmés et emmenés
en captivité, ces malheureux jeunes gens venaient de traverser le village
de Passavant , lorsque l'un d'eux quitta les rangs pour aller se désaltérer au
ruisseau du chemin.
Un soldat de l'escorte tire sur lui, et les Prussiens, se croyant attaqués,
chargent impitoyablement les infortunés mobiles.
Une reconnaissance de cavalerie fait feu sur eux; puis, l'infanterie cantonnée dans
le village se mêle à cette attaque, et bientôt les deux côtés de la route sont
jonchés de blessés et de cadavres.
Les Prussiens mettent tant d'acharnement dans cette horrible mêlée, où l'on tue à bout
portant des prisonniers sans armes, que ceux mêmes qui n'ont pas quitté leurs
rangs ne sont point épargnés; trente-deux d'entre eux sont massacrés,
quatre-vingt-douze mutilés, et plusieurs vont périr misérablement et sans secours
dans les champs où ils s'étaient cachés.
Dix mois après cette scène sanglante, on retrouvait dans les bois de Passavant ,
soutenus par les grosses branches d'un chêne, les débris d'une victime que
l'on put encore reconnaître c'était un pauvre mobile qui s'était réfugié là pour
éviter les coups de ses meurtriers, et qui, trop grièvement blessé, n'avait
pu redescendre.
C'est par de tels exploits que les cavaliers du Schleswig-Holstein payaient leur
bienvenue à la Prusse.
Un de leurs
chefs, commandant le 15e régiment de uhlans, le major baron de Friesen, tomba
sous la balle d'un mobile champenois, et paya de sa vie la charge "inutile" qu'il
avait conduite; quant aux acteurs de Passavant, les héros du 16e hussards, c'est
à Ablis, où nous les rencontrerons plus tard, qu'ils trouveront leur châtiment.

 Corps francs
Corps francs
 La garde mobile
devait avoir pour auxiliaires les corps francs; malheureusement, en ce qui concerne
cette dernière création, le gouvernement impérial avait commis la même faute que
pour la précédente.
La garde mobile
devait avoir pour auxiliaires les corps francs; malheureusement, en ce qui concerne
cette dernière création, le gouvernement impérial avait commis la même faute que
pour la précédente.
On se rappelle le mouvement patriotique qui se manifesta dans nos provinces
de l'Est après Sadowa: un grand nombre de volontaires demandèrent à s'organiser
en compagnies.
C'était un mouvement qui, au moment du danger, aurait pu nous donner plus de
cent mille hommes, armés, équipés, prêts à marcher, et surtout exercés à la
pratique du tir.
Après avoir passé en revue le premier bataillon des francs-tireurs de l'Est,
on lui donna une fête à Paris, puis on autorisa la formation des compagnies franches,
mais à la condition qu'elles entreraient dans la garde mobile, qui, on l'a vu,
n'existait elle-même que sur le papier.
Après ses premières défaites, l'Empire
fut réduit à exciter le mouvement qu'il avait lui-même entravé deux ans plus tôt;
mais cette création allait forcément se ressentir de la précipitation des événements,
car ce n'est pas en un jour qu'on forme des tireurs.
Plus tard, le gouvernement de la défense nationale favorisa également par tous les moyens
le recrutement des corps francs, et il alla même au delà du but en donnant une
importance exagérée à ces milices indépendantes, dont le nombre successivement
accru finit par dépasser trente mille hommes.
Il n'est presque pas de bourg tant soit peu important qui n'ait eu sa compagnie franche,
et les grandes villes les multipliaient à l'envi.
Dans ces corps, il y avait en moyenne un officier pour une escouade,
un capitaine et quelquefois un officier supérieur pour une section,
et un colonel pour un demi-bataillon.
On encourageait par ce morcellement les ambitions personnelles ou les rivalités de clocher,
et au lieu de condenser nos forces, on les laissait s'émietter en mille commandements divers.
En outre, cette institution porta le dernier coup au respect de la discipline,
en propageant dans le pays le principe de l'élection pour la collation des grades.
L'élu est généralement considéré comme le mandataire de l'électeur,
et les francs-tireurs étaient assez disposés à croire que les officiers
nommés par eux devaient être leurs serviteurs obéissants.
Il en résultait que le commandement était faible à tous les degrés;
on rencontrait d'un grade à l'autre un manque presque complet de confiance
et d'autorité, et l'on peut dire que, sauf de rares exceptions, les chefs de corps
francs menaient leurs hommes à la condition de leur obéir.
L'habillement et l'équipement des francs-tireurs étaient relativement
soignés; ils avaient tous des fusils perfectionnés; payés par l'État,
ils touchaient en outre une haute paye de leurs municipalités,
sans préjudice des indemnités qui étaient allouées à leurs femmes,
et presque tous étaient mariés.
Ceux qui jadis étaient les premiers à crier contre les priviléges formaient
donc, sous le rapport de la solde et des accessoires, une véritable troupe privilégiée.
Un décret du 29 septembre avait mis les francs-tireurs à la disposition
du ministre de la guerre, mais ils continuèrent néanmoins à agir isolément.
Quant aux opérations qu'ils avaient en vue, et dont nous aurons souvent l'occasion
de parler, c'étaient les coups de main, les surprises et les embuscades,
dans lesquelles la ruse, l'intelligence et l'audace luttent contre la force;
opérations qui, en échange d'une plus grande indépendance, exigent des chefs
qui les dirigent une plus grande somme de facultés individuelles.
Par malheur, outre les vices inhérents à l'institution et que nous avons signalés,
les corps francs ne se trouvaient pas dans des conditions à faire la guerre de
partisans telle qu'on la comprend d'ordinaire, et qui consiste à enlever les
convois de l'adversaire et à inquiéter ses derrières ou ses flancs.
Ils étaient réduits à agir devant le front de l'ennemi, à l'aiguillonner mal à propos,
à harceler ses éclaireurs et à faire en un mot ce que l'on a si justement appelé
"la chasse aux Prussiens".
Cette chasse, lors même qu'elle était infructueuse, ne manquait presque jamais
d'attirer des représailles, le bombardement, le pillage et l'incendie de
la commune sur le territoire de iaquelle avait été tendue l'embuscade;
en sorte que les malheureux habitants de nos campagnes, au lieu
d'être protégés par les francs-tireurs, étaient gravement compromis par leur présence.


 Garde nationale
Garde nationale
Aux éléments que nous venons d'énumérer et de passer rapidement en revue, ligne, garde mobile, corps francs, si nous ajoutons pour mémoire,la garde nationale sédentaire, réorganisée sur de nouvelles bases par un décret du 12 août et chargée du maintien de l'ordre et de la défense locale, nous aurons l'ensemble des ressources militaires dont on pouvait disposer au mois de septembre, dans les provinces de l'Ouest comme dans le reste de la France.
SUITE ...