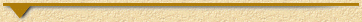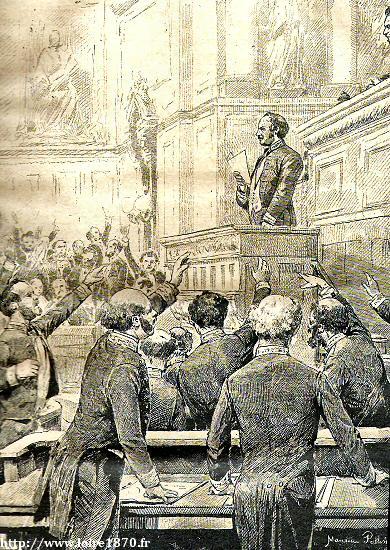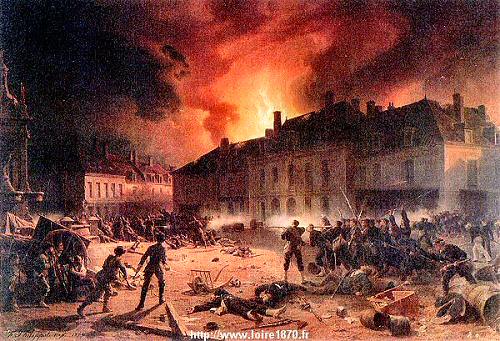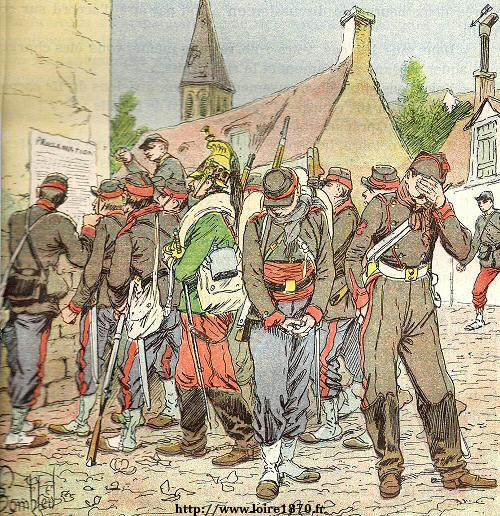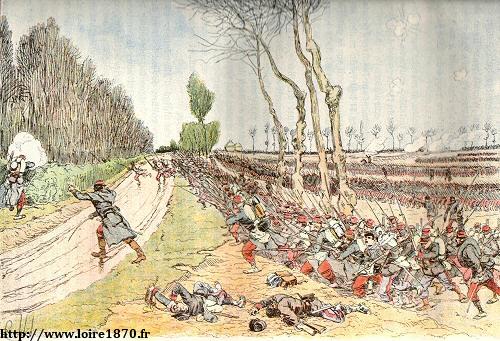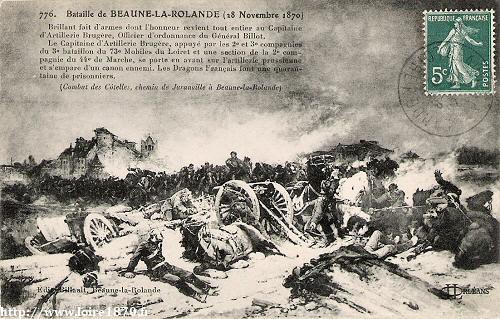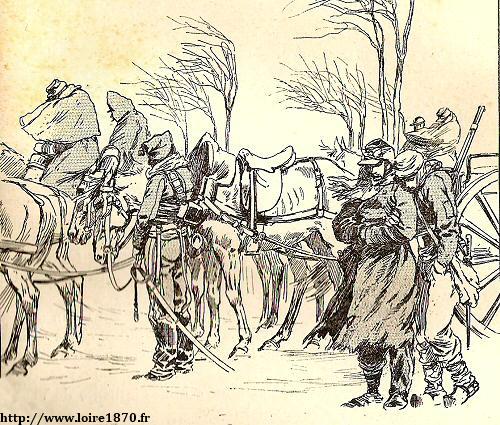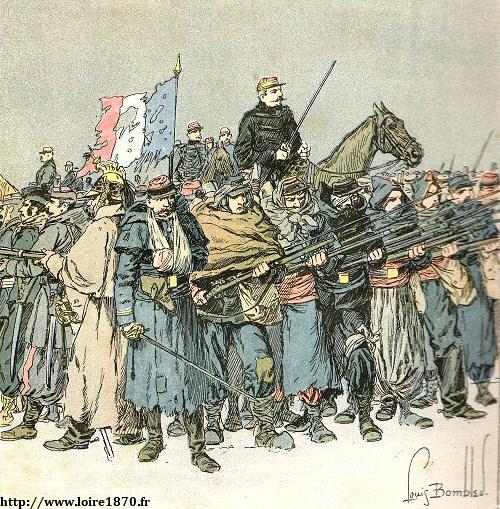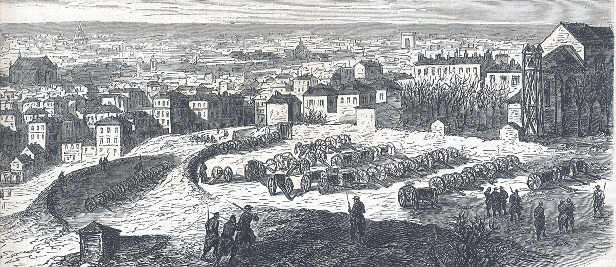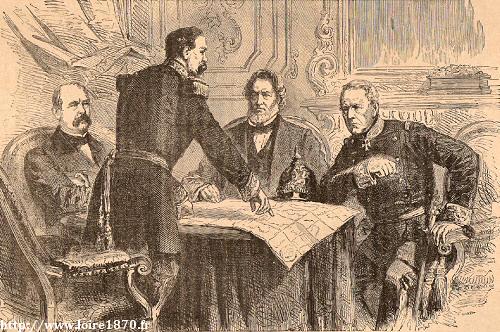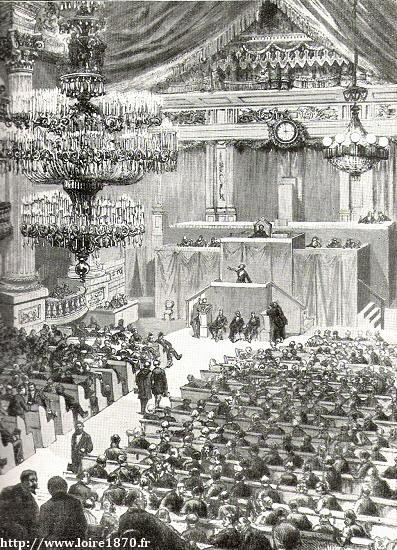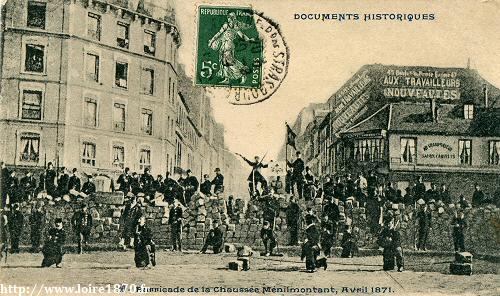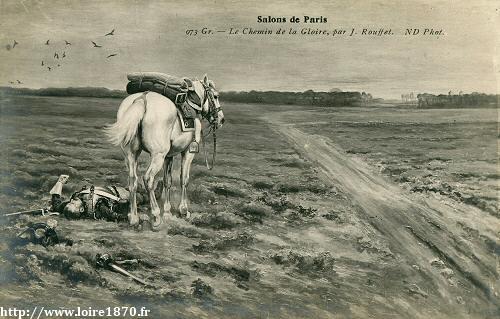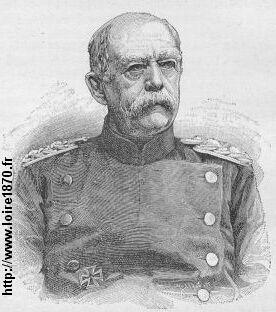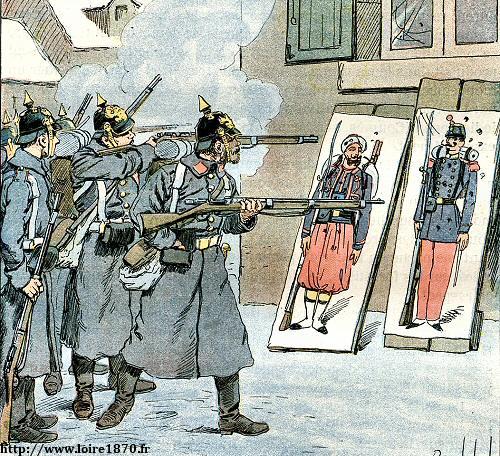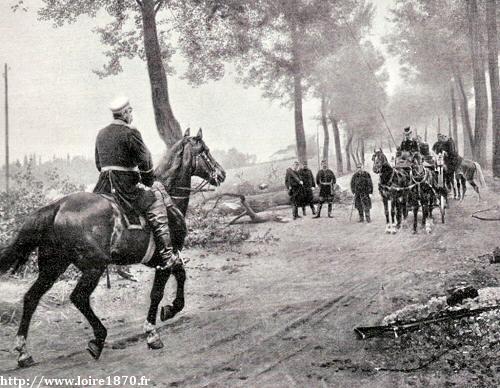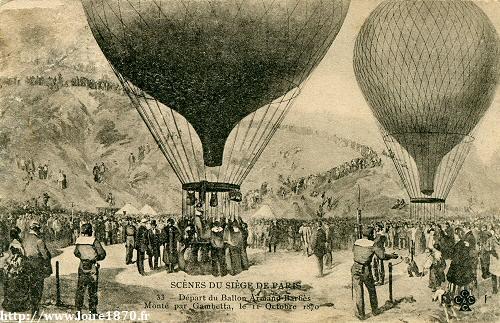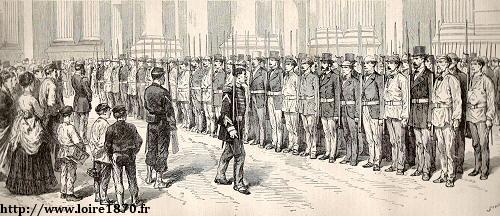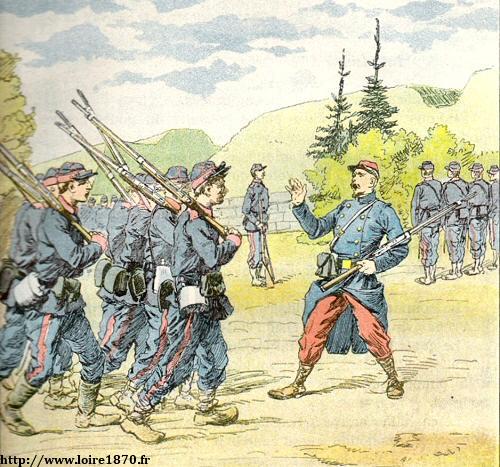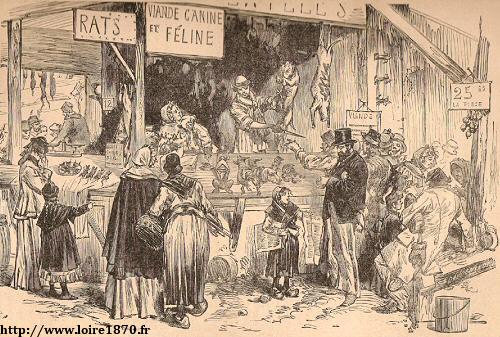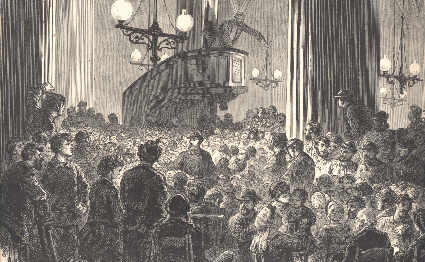Rappels des causes de la guerre
Rappels des causes de la guerre
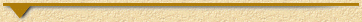
En 1870, l'Allemagne est composée d'un grand
nombre d'Etats. En 1815, au congrès de Vienne, une "Confédération germanique" avait été créée
dans les limites de l'ex-Saint-Empire romain germanique, dont l’empereur d’Autriche assumait la présidence.
Toutefois, la Prusse, confiante en sa puissance militaire, conteste la prééminence autrichienne,
et souhate réunifier les Etats Allemands (sans l'Autriche) sous son autorité.
En 1866, après avoir acheté la non-intervention de Napoléon III en
lui promettant la Belgique ou le canton de Genêve, la Prusse entre en conflit avec l'Autriche.
Suite à sa défaite à Sadowa, l'Empire autrichien perd sa suprématie sur l'espace germanique
et doit abandonner ses droits sur les États allemands au profit de la Prusse.
Bismarck crée la "Confédération de l'Allemagne du Nord" ; il conserve l'indépendance des Etats du Sud
(Bavière, Wurtemberg, Bade, Hesse) mais conclut avec eux des traités de défense mutuelle
afin d'y étendre la sphère d'influence de la Prusse.
|
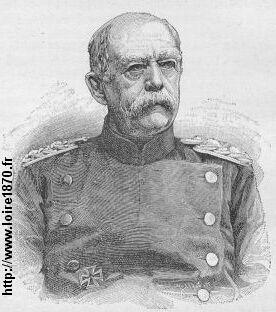
Otto Von Bismarck
|
Mais Bismarck,
ministre des affaires étrangères de Prusse, n'entend pas céder de compensation
territoriale à Napoléon III.
Il est hostile à la France, ennemi héréditaire, qu'il accuse de vouloir faire
obstacle à une unification en voulant s'approprier des pays d'origine
allemande; de plus, une guerre contre la France lui semble bienvenue pour récupérer
l'Alsace et la Lorraine, et pour pousser les Etats du Sud à se rallier
à la Prusse.
Mais un prétexte est nécessaire pour
lui déclarer la guerre, car ceux-ci ne se rallieront
que pour secourir une Prusse "agressée".
|
|
En France, aussi la guerre est souhaitée par beaucoup. Sous la
pression républicaine grandissante, Napoléon a dû
renoncer à son pouvoir absolu pour passer à un régime
parlementaire. L'entourage du souverain aspire à une guerre
dont la victoire certaine,
en rendant au régime impérial son ancienne popularité,
lui permettrait de restaurer une autorité despotique.
L'Espagne qui a contraint sa souveraine
à abdiquer, offre le trône de Madrid au prince Léopold
de Hohenzollern, cousin du roi de Prusse.
Le 6 juillet, le ministre
Français des affaires étrangères déclare
que :
" le gouvernement ne souffrirait pas qu'une puissance étrangère,
en plaçant un de ses princes sur le trône de Charles-Quint,
puisse déranger à notre détriment l'équilibre
actuel des forces en Europe, et mettre en péril les intérêts
et l'honneur de la France. Si cette éventualité se réalisait,
nous saurions remplir notre devoir sans hésitation et sans faiblesse ".
Les Allemands prennent mal ce ton menaçant. Toutefois, le 12,
L. de Hohenzollern abandonne sa candidature.
Le 13, l'empereur, poussé
par son entourage, demande au roi de Prusse de s'engager à ne
jamais permettre au prince de revenir sur cette renonciation.
Les Allemands s'offusquent de cette demande jugée excessive et arrogante.
Le roi répond à l'ambassadeur Français qu'il refuse
de s'engager davantage.
L'ambassadeur demande à être reçu
à nouveau par le roi. Un aide de camp vient lui dire que le roi
ne pouvait faire plus. |
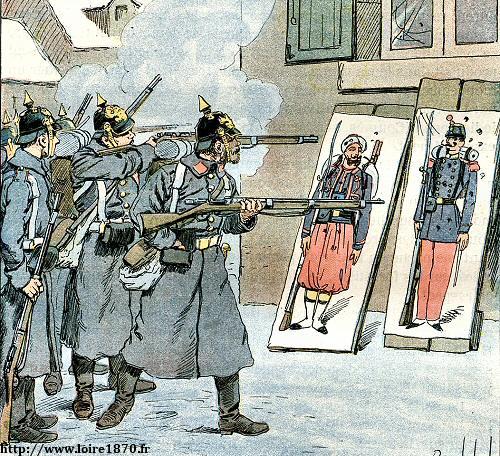
L'ennemi héréditaire (Dessin de Bombled - 1895)
|
|

|
Bismarck déclare alors (dépêche d'Ems) :
" Sa Majesté a refusé de recevoir
de nouveau l'ambassadeur Français ".
Les Français se sentent outragés par ce refus. Les esprits
s'échauffent de part et d'autre, encouragés par Bismarck
d'un côté, par l'entourage de Napoléon III de l'autre,
au point que la guerre se trouve déclarée le 18 juillet,
par la missive suivante de la France à la Prusse :
"Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français,
ne pouvant considérer le projet d'élever un prince prussien
au trône d'Espagne que comme une entreprise dirigée contre
la sécurité territoriale de la France, s'est vue forcée
de demander à Sa Majesté le roi de Prusse l'assurance
qu'une pareille combinaison ne se reproduirait plus à l'avenir
avec son assentiment. Sa Majesté le roi de Prusse ayant refusé
cette assurance et, ayant, au contraire, déclaré à
l'envoyé de Sa Majesté l'Empereur des Français,
qu'il voulait se réserver, pour cette éventualité
comme pour toute autre, de consulter les circonstances, le gouvernement
impérial a dû voir dans cette déclaration du roi
une arrière-pensée menaçante pour la France et
pour l'équilibre européen.
Cette déclaration a reçu un caractère encore plus
sérieux par la communication faite aux cabinets étrangers
du refus de recevoir l'envoyé de l'Empereur et d'entrer avec
lui dans de nouvelles explications. En conséquence, le gouvernement
Français a cru de son devoir de songer sans délai à
la défense de sa dignité blessée, de ses intérêts
menacés, et résolu, dans ce but à prendre toutes
les mesures qui lui sont ordonnées par situation qui lui est
faite, il se considère dès à présent, comme
en état de guerre avec la Prusse."
|
 Rappels des événements principaux de la guerre
Rappels des événements principaux de la guerre
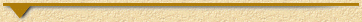
|
(Les différentes tendances politiques dans
le pays sont :
les bonapartistes, les monarchistes (les légitimistes
qui sont partisans de la branche aînée, et les orléanistes
qui soutiennent la branche d'Orléans), les républicains
modérés, et les républicains extrémistes (révolutionnaires).)
La guerre est déclarée à la Prusse le 18 juillet.
Le 28 juillet, après avoir confié la régence à
l'impératrice, Napoléon III arrive à Metz.
Il
n'a déclaré la guerre que sous la pression de la cour.
Lui seul ne partage pas l'enthousiasme général en raison
de son état de santé; atteint de coliques néphrétiques,
il peine à se tenir à cheval, et à assurer correctement
son rôle de chef des armées.
Une seule armée est créée, dite
du Rhin. Après plusieurs défaites successives, une
partie de celle-ci (appelée armée de Châlons) est battue à Sedan.
|
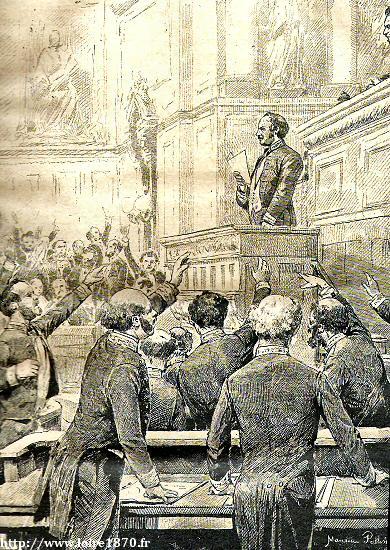
|

L'Impératrice Eugénie (Dessin de J. L. , 1913)
|
A Paris, la consternation d'une défaite jusque là
inimaginable et le désarroi évident d'une armée
qu'on disait si bien préparée mettent fin à
la confiance dans le gouvernement impérial.
Sous la pression populaire, l'impératrice charge le Comte
de Palikao
(monarchiste) de former un nouveau ministère. |
|
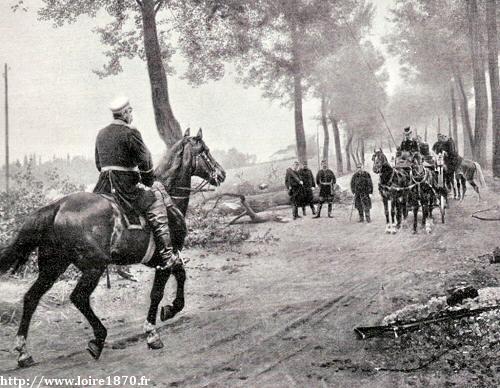
Rencontre de Bismarck et Napoléon III (Tableau de A. von Werner)
|
Napoléon veut rentrer à Paris, et y ramener l'armée
pour se préparer au siège. Ce qui est militairement
sage, mais l'impératrice ne le souhaite pas.
Elle craint que son retour après la défaite ne provoque un
soulèvement qui fasse perdre le trône à son fils.
Napoléon III va alors trouver Bismarck, pour négocier
la capitulation de Sedan, et est fait prisonnier.
Les soldats de l'armée
de Châlons doivent être désarmés et conduits
en Allemagne.
En attendant leur départ, ils sont entassés
dans une presqu'île de la Meuse, sans vivres ni protection contre
les intempéries;
ils en sont réduits, pour ne pas
mourir de faim, à manger les chevaux, eux-même faméliques.
(voir "La débâcle" d'Emile Zola).
A Paris, le 4 septembre, suite à la capitulation de Sedan,
l'Assemblée, sous la pression des révolutionnaires de la rue,
proclame la fin de l'empire et l'avènement de la 3ème république.
|

|
L'impératrice s'enfuit en Angleterre.
Un gouvernement
provisoire républicain est formé, qui se veut, non le gouvernement
d'un parti, mais le "gouvernement de la défense nationale".
Le général Trochu (républicain modéré), devenu populaire pour
avoir signalé les insuffisances de l'armée, en a la présidence;
Gambetta (républicain modéré) devient ministre de l'intérieur. |

Proclamation de la République devant l'Hôtel de Ville de Paris
(Le Monde Illustré de 1870, dessin de A. Daudenarde)
|
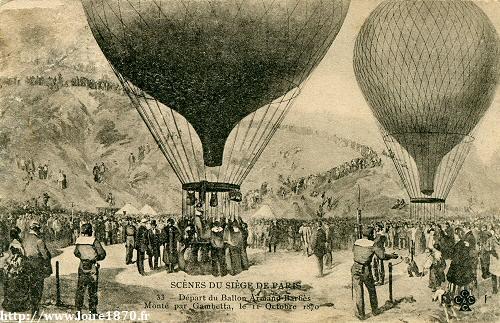
Départ du ballon Armand Barbès, monté par Gambetta, le 7 octobre 1870 |
L'ennemi se prépare à assiéger Paris.
Le gouvernement ne pourra plus communiquer avec le reste de la France.
Il est sage de le transférer en province,
mais le gouvernement considère la République comme intimement
liée à la ville de Paris, et décide
de partager avec les parisiens la menace ennemie.
Toutefois, il est décidé d'envoyer à Tours une
délégation
subordonnée.
Le 18 septembre, les Allemands assiègent Paris.
Comme
la délégation conteste les instructions du gouvernement,
Gambetta est envoyé en ballon à Tours le 7 octobre.
Il doit représenter l'autorité supérieure du
gouvernement face à la délégation.
La communication
entre les deux ne pouvant plus se faire qu'à l'aide de pigeons
et de ballons, le gouvernement ne gouverne plus que
Paris. |
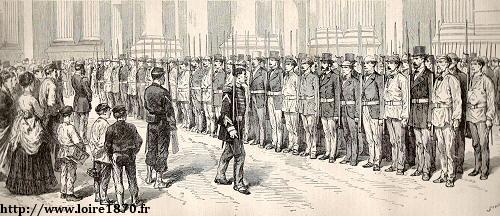
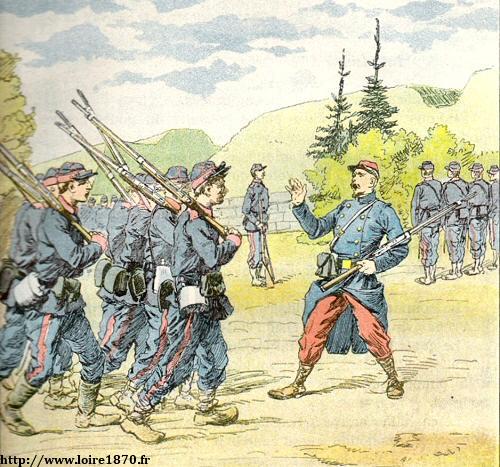
|
De ce fait, c'est Gambetta (ajoutant la
charge de ministre de la guerre à celle de l'intérieur)
qui gouverne le reste de la France, conseillé par un ingénieur
des mines : Charles de Freycinet.
La France n'a plus d'armée régulière.
Les célibataires
et veufs sans enfants jusqu'à 35 ans ont été recrutés dès août.
Fin septembre, Gambetta y ajoute les célibataires et veufs sans
enfants de 35 à 40 ans (la levée en masse).
Il entreprend de les équiper et de les envoyer dans des camps
d'instruction pour former la garde nationale mobilisée.
Il fait appel à tous les hommes de bonne volonté.
C'est ainsi qu'il accueille les combattants d'Italie : Charette
commandant les zouaves pontificaux, et Garibaldi.
Les autorités Françaises
se trouvent dans l'embarras face à l'offre de renforts
de Garibaldi et de sa troupe de "chemises rouges";
le 8 octobre,
il est décidé de ne pas l'incorporer dans l'armée
régulière et de lui attribuer une statut équivalent
aux corps francs.
Il entreprend à Autun une guérilla avec
cette "armée des Vosges".
L'Armée des Vosges capitule à Dijon le 31 octobre.
Le gouvernement désapprouve les efforts de Gambetta pour recréer
une armée et n'y voit que gaspillage et inutilité face à un conflit bien mal
engagé.
De plus, il n'approuve pas le régime "dictatorial" de Gambetta, sur lequel
il n'a plus de pouvoir, et qui "purifie le personnel administratif"
en remplaçant les fonctionnaires importants par des républicains
partisans de Gambetta.
|
|
Plusieurs villes sont défendues efficacement
par des francs-tireurs et des gardes nationaux.
Ces faits d'armes revalorisent
les troupes improvisées aux yeux des troupes régulières
qui doutent de leur efficacité, et galvanisent la résistance
de la population.
Les Allemands eux-même s'étonnent
de ces nouvelles forces de résistance après la neutralisation
de l'armée régulière.
Molkte doit reconnaître
"la force d'endurance et l'obstination des Français;
toute l'armée Française est prisonnière en Allemagne,
et il y a plus de belligérants en armes contre nous qu'au début
de la campagne", et il s'en prend à "la puissance
de la phrase sur les Français". |
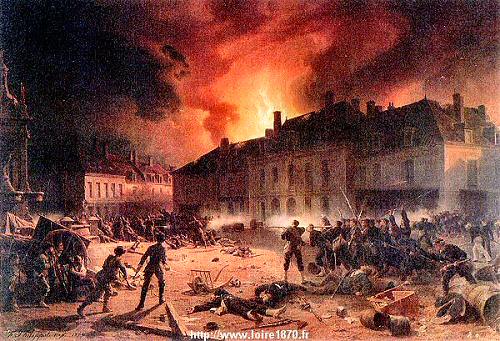
18 octobre : Incendie de Châteaudun |
|
Mais les Allemands ne reconnaissent
qu'aux troupes régulières le droit de faire la guerre,
et pas aux corps francs, ni aux habitants du pays.
Ils proclament : "nous ne faisons pas la guerre aux
habitants paisibles de la France, et le
premier devoir d'un soldat allemand loyal est de protéger la
propriété".
Les particuliers Français
ne devaient pas être molestés, et il faut reconnaître
qu'il ne le furent pas; les soldats Allemands, fortement disciplinés,
commettent peu de violences.
Mais si les habitants défendent
leur ville, les Allemands alors l'incendient, arrêtent les
notables, fusillent des habitants et les francs-tireurs.
Il leur arrive de contraindre les élus locaux à les accompagner
dans les trains pour dissuader les attaques et
les sabotages des voies ferrées.
Ils imposent aux villes
investies de lourdes contributions dont ils en rendent garants
les élus. |
 |
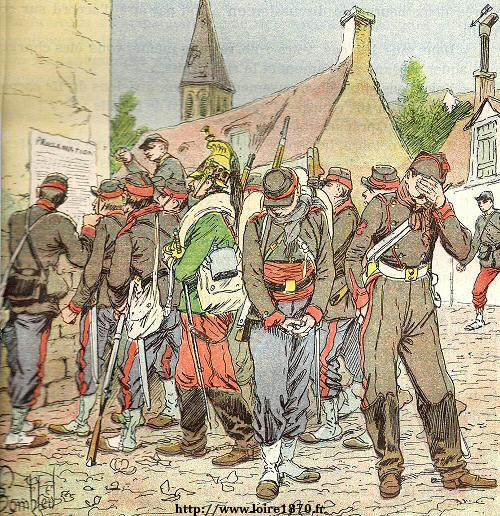
Soldats lisant l'affaire de la capitulation de Metz
(Dessin de Bombled - 1895) |
Le reste de l'armée du Rhin, sous le commandement
de Bazaine, est cerné à Metz.
Le maréchal désapprouve le nouveau régime
républicain, et projette l'utilisation de son armée pour
restaurer l'empire.
Il essaye, contrairement à son devoir de militaire, de négocier avec
l'ennemi la paix pour son armée, et leur offre en échange
sa contribution à la mise en place d'un pouvoir reconnu par tous
les Français.
Les Allemands refusent.
Bazaine capitule le 27 octobre. (Jugé en 1873,
il fut condamné à mort pour ses négociations avec
l'ennemi, mais fut gracié et enfermé dans une forteresse
d'où il s'évada.)
A Paris, le 31 octobre, la nouvelle de la capitulation de Metz,
provoque une insurrection des forces populaires révolutionnaires
et des gardes nationaux mobilisés.
Ils font prisonnier le gouvernement qui est bientôt délivré par l'armée régulière.
|
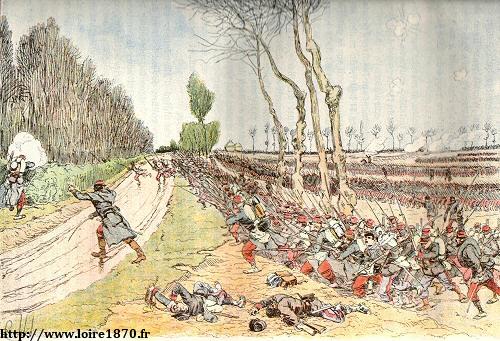
(Dessin de Bombled - 1895) |
Après la capitulation de Metz et de l'armée
du Rhin, les troupes allemandes peuvent avancer sans obstacles sur le
territoire :
Frédéric-Charles progresse vers la Loire, et Manteufel
se dirige vers le Nord.
Denfert-Rochereau résistant
toujours dans Belfort assiégé, la guerre va se poursuivre
sur 3 théâtres d'opération : sur la Loire, dans
le Nord, et l'Est (Bourgogne et Franche-Comté).
Gambetta pousse ses généraux à une offensive
pour délivrer Paris, mais ceux-ci, souvent âgés,
peu accoutumés par la guerre d'Afrique à des offensives
de telles ampleurs, et doutant de la compétence des troupes irrégulières,
tergiversent.
Gambetta crée l'armée de la Loire, et met à
sa tête le général d'Aurelle de Paladines.
Celui-ci y établit la discipline, difficile dans cette armée
non régulière, en appliquant le décret du 2 octobre,
qui accélère les procédures de jugement et qui
permettent de fusiller l'accusé le lendemain matin.
Le 9 novembre, l'armée de la Loire est victorieuse des Bavarois
à Coulmiers et reprend
Orléans abandonné par les Allemands; le 28 novembre,
elle est repoussée à Beaune-la-Rolande. |
Le 1e décembre, le général Ducrot tente une sortie de Paris, mais est
battu à Champigny.
Gambetta décide de diriger l'armée
de la Loire vers Paris pour lui venir en aide.
Le 2 décembre,
les Français, malgré l'intervention glorieuse
du général de Sonis à la tête des vaillants
volontaires de l'Ouest, (mobiles, francs-tireurs bretons et
anciens zouaves pontificaux), sont défaits à Loigny.
Les Allemands réoccupent Orléans sans combattre.
L'armée de la Loire est alors coupée en 2 : la partie
Est, commandée par Bourbaki, marche sur Belfort pour tenter
de délivrer Denfert-Rochereau toujours assiégé;
Chanzy prend la tête de la partie ouest, qu'on appelle la 2ème
armée de la Loire.
Le gouvernement est transféré à Bordeaux. |
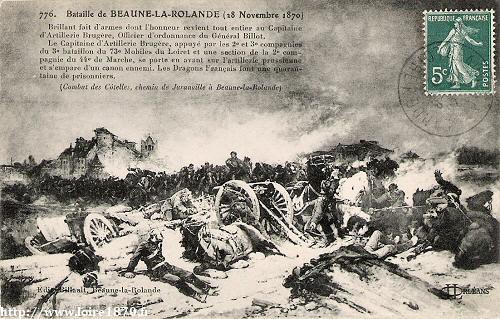
28 novembre : Beaune-la-Rolande |
|
La situation devient très
difficile avec l'arrivée de l'hiver; les soldats ayant
des vêtements et des chaussures de mauvaise qualité
les protégeant mal des intempéries.
De plus, les généraux (sauf Chanzy) refusent de
les cantonner la nuit chez les habitants, de peur d'indiscipline.
Aussi, les hommes doivent bivouaquer sous la pluie ou par -10°C,
souvent sans paille dans la boue ou la neige, et quelque fois
même sans tente ou couverture.
Le moral et la santé des troupes s'en ressentent fortement.
Sur le front de la Loire, Chanzy est battu par Frédéric-Charles
à Beaugency (appelée aussi bataille de Villorceau),
et se replie sur le Mans le 19 décembre. |
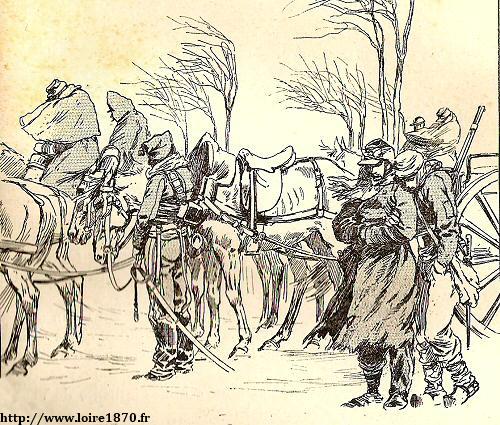
(Dessin de Bombled - 1895)
|
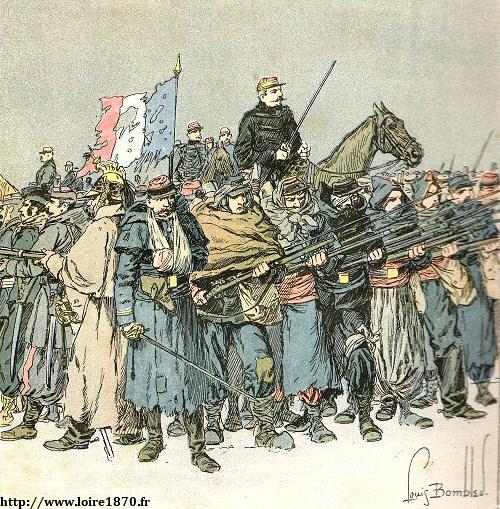
(Dessin de Bombled - 1895) |
Le 12 janvier, la 2eme armée de la Loire est battue au
Mans et se replie sur Laval, où les Allemands épuisés
ne la poursuivent pas; ils se contentent d'envoyer
quelques détachements en reconnaissance vers Laval.
Sur le front
Est, l'armée de l'Est combat à Nuits le 19 décembre,
puis à Villersexel le 9 janvier, où elle est victorieuse
face à l'armée de Werder.
Du 15 au 17 janvier, les Français sont battus à Héricourt soit à seulement
15 km de Belfort.
Les Français épuisés essaient
de se replier sur Besançon, mais l'armée allemande leur
coupe la retraite, l'acculant à la frontière Suisse.
Sur le front Nord, l'armée du Nord est battue à
Amiens le 27 novembre, et les Allemands occupèrent Rouen.
Elle reprend Amiens le 9 décembre, attaque les
Allemands sur leur flanc nord et les fait reculer à Pont-Noyelles
le 23 décembre; puis elle reperd Amiens, mais fait reculer
les Allemands sur Bapaume le 4 janvier.
Elle marche sur Paris,
mais le 19 janvier, elle est vaincue à Saint-Quentin
et fait une retraite vers le Nord. |
|
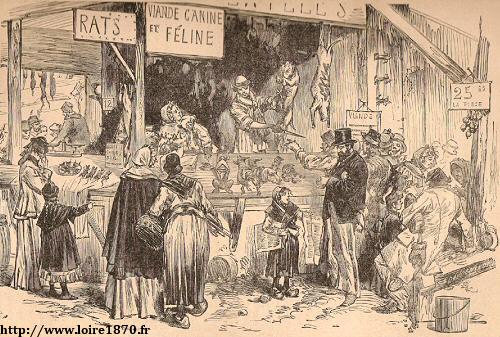
Boucherie canine et féline à Paris
(Dessin de Bouard 1910 ?)
|
A paris, on ne se chauffe plus, et
les vivres sont rationnés et de mauvaise qualité.
La ration quotidienne par tête est tombée
à 300g de pain, à 30g de viande.
Le pain, coupé
de paille hachée, est infect et on mange du chien,
du chat, et du rat.
Fin décembre, on compte 3600 décès
par semaine, surtout parmi les enfants et les vieillards.
|
|
La population affamée
accuse le gouvernement de partialité dans le partage
des vivres.
La disette et les bombardements exacerbent les passions
du peuple dans son désir de victoire et de liberté.
Les orateurs révolutionnaires, et le comité central
de la garde nationale, accusent le gouvernement de trahison
et lancent leurs solutions hasardeuses, devant un public tout
acquis qui s'enflamme à leurs harangues.
|
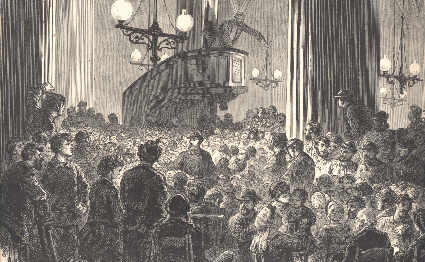
Orateur haranguant dans un club installé
dans une église
(L'Illustration de 1871, dessin de Smeetom)
|
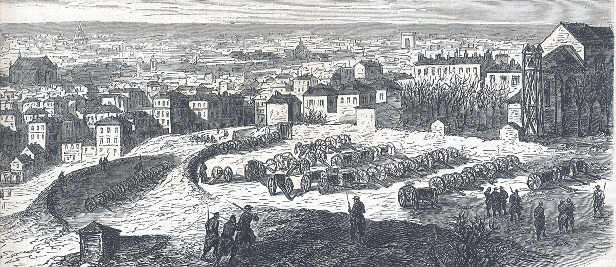
Les parisiens parquent les canons de la garde nationale
(L'Illustration de 1871, dessin
de J. Gaildreau et Smeetom)
|
Le 18 janvier, Ducrot tente à nouveau de sortir de Paris et échoue.
Les bataillons de la garde nationale reviennent exaspérés pensant
qu'on a essayé de les sacrifier afin d'éliminer
leur contestation.
Le 22 janvier, c'est l'émeute : ils attaquent
l'hôtel de ville; les troupes régulières et les
mobiles ripostent et tirent sur la foule.
Les vivres étant épuisées, le gouvernement signe
la capitulation de Paris le 28 janvier, et un armistice.
Celui-ci est signé pour 21 jours, et exclut le front de l'Est jusqu'au
moment où un accord aura été trouvé sur la nouvelle ligne frontalière.
|
Le gouvernement obtint qu'à Paris, une division et la garde
nationale mobilisée restent armées (ce qu'il regrettera
fort par la suite des événements).
Les Allemands veulent faire la paix avec une France représentative.
Aussi, il est prévu de procéder à une réélection
de l'Assemblée Nationale qui décidera de continuer la
guerre ou non.
Le gouvernement ordonne à Gambetta de
mettre en place l'armistice en province, mais il ne lui est pas précisé
l'exception du front Est!
Gambetta s'exécute.
L'armée de l'Est, surprise, est attaquée.
Décimée, elle s'enfuit en Suisse, où elle est désarmée.
|
|
Après l'armistice, 400 000 hommes sont prisonniers
en Allemagne, 100 000 hommes sont internés en Belgique (suite
à Sedan) et en Suisse, et l'armée de Paris est désarmée.
Les Allemands occupent 43 départements avec 570 000 hommes
d'infanterie et 63000 hommes de cavalerie.
Des calculs officiels montrent
que les Français ont encore 220 000 fantassins, 20 000 cavaliers, 34 000
artilleurs, 1232 canons attelés.
Et 350 000 hommes dans les divisions territoriales, 100 000 recrues
de la classe 1870, 443 canons montés, et 98 batteries fournies
par les départements.
Mais les commissaires, sans attendre le résultat de l'enquête,
concluent qu'ayant à peine, outre les mobilisés, 85 000 soldats ou marins
et 135 000 mobiles, la résistance n'est plus possible.
|
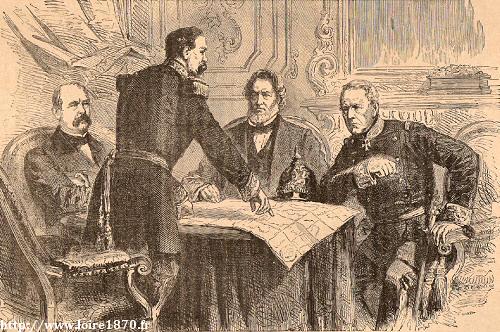
|
|
Les élections législatives ont lieu le 8 février
au scrutin universel (moins les femmes) afin d'élire une nouvelle
Assemblée Nationale.
Sont élus plus de 400 monarchistes, environ 200 républicains,
30 bonapartistes.
Ils désignent
Thiers (monarchiste, avant de devenir républicain modéré)
chef du pouvoir exécutif pour négocier le traité
de paix avec les prussiens.
La population parisienne est hostile à l'arrivée des Allemands
dans la capitale prévue pour le 1er mars.
Des barricades sont
constituées autour des quartiers dont les Allemands doivent prendre
possession.
Les parisiens font évacuer la population de ces quartiers et retirent
les canons de la garde nationale qu'ils ne veulent pas rendre à
l'ennemi.
Ainsi, les Allemands défilent
place de la Concorde, dans un Paris silencieux et désert; ils
se replient le lendemain.
Maladroitement, Thiers décide de supprimer les journaux révolutionnaires,
de poursuivre les activistes du 31 octobre, d'abolir la suspension de
paiement des loyers et crédits en cours, de supprimer la solde
de la garde nationale, et de reprendre ses canons.
|
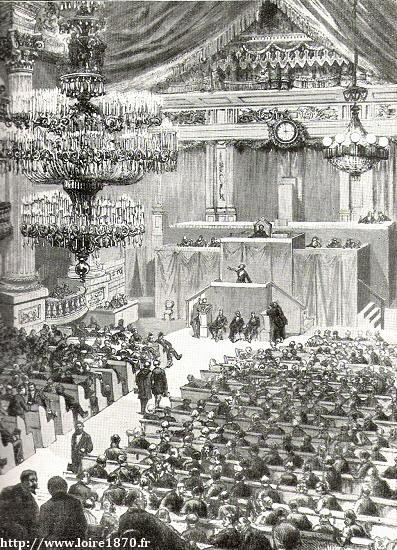
|
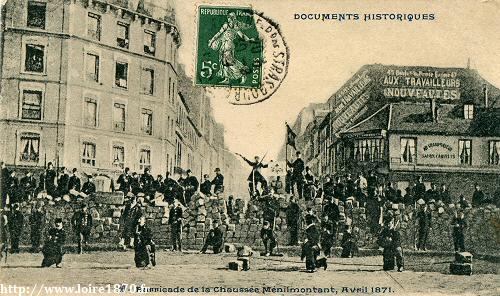 |
Il fait afficher la proclamation suivante :
"Des hommes malintentionnés affichent la prétention de vous défendre
contre les prussiens, qui n'ont fait que paraître dans vos murs.
Ils braquent des canons, qui s'ils faisaient feu, ne foudroieraient que vos maisons, vos enfants
et vous-mêmes; et compromettent la République, au lieu
de la défendre, car, s'il s'établissait dans l'opinion
de la France que la République est la compagne nécessaire
du désordre, la République serait perdue !
Tant que dure
cet état de choses, le commerce est arrêté, les
commandes qui viendraient de toutes part sont suspendues, vos bras sont
oisifs, le retour au travail et à l'aisance sont empêchés."
Le 18 mars, il tente de reprendre de force ces canons avec la division
en armes autorisée par les prussiens, et
de reprendre le contrôle militaire de Paris.
|
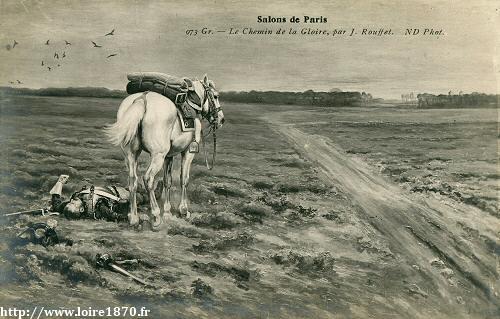 |
Mais la population et la garde nationale se soulèvent
spontanément (sans l'influence des chefs révolutionnaires),
et occupent les principaux monuments de Paris.
Le gouvernement,
et les troupes régulières qui ne se rallient pas aux insurgés,
se réfugient à Versailles. C'est la commune ...
Le traité de paix est signé le 10 mai 1871 à Francfort.
La France doit verser 5 milliards, céder l'Alsace
et une partie de la Lorraine; les départements servant de gage
à la dette Française sont libérés au fur
et à mesure des versements.
Les derniers versements seront versés
en septembre 1873, et les derniers Allemands quitteront le territoire
Français.
Cette guerre a coûté aux Allemands : 47 000 morts soit
14% des effectifs, dont la moitié sont morts de maladie. Et 128
000 blessés, 100 000 malades.
Elle a coûté aux Français : 139 000 morts au
combat ou de maladie, 143 000 blessés, 320 000 malades; ces chiffres
plus lourds que les Allemands, comprennent aussi les civils touchés
par les bombardements et la famine. |



 Rappels des causes de la guerre
Rappels des causes de la guerre 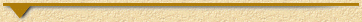
 Rappels des événements principaux de la guerre
Rappels des événements principaux de la guerre