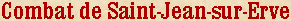
15 janvier 1871

Monographie rédigée sur Saint-Jean-sur-Erve
par l'instituteur pour l'exposition universelle de 1900
Ce texte trouve ses sources dans la brochure :
"Inauguration
solennelle du monument élevé à Saint-Jean-sur-Erve"
, Laval, Imprimerie mayennaise, 1898.


.

L'amiral Jauréguiberry ne recule qu'à contre-coeur : " Je suis désolé de battre
en retraite, écrit-il à Chanzy.
Si je n'avais avec moi un matériel considérable
qu'il faut essayer de sauver, je m'efforcerais de trouver une poignée d'hommes
déterminés et de lutter même sans espoir de succès... Je ne me suis jamais
trouvé depuis 39 ans que je suis au service dans une position aussi navrante
pour moi."
Aussi, arrivé au milieu de la nuit du 14 au 15 à Saint Jean sur
Erve, dès le petit jour, se mit √† √©tudier le terrain et le jugeant
avantageux pour la r√©sistance, il se r√©sout aussit√īt √† faire t√™te √† l'ennemi
; il veut tenter, à tout prix, de l'arrêter dans sa poursuite.
Il n'a avec lui que les faibles restes des deux premières divisions du 16e
corps.
Du premier coup d'oeil, l'amiral a vu le parti qu'il peut tirer des hauteurs
qui dominent le village en amphith√©√Ętre.
Il ordonne à une section du génie de pratiquer des embrasures dans les talus
du chemin creux qui contourne la colline, pour y établir quatre batteries,
deux de pièces de 4 et deux de mitrailleuses avec la mission de battre la
route du Mans à Laval.
Il commande à une autre section du génie de préparer
la destruction du pont de Saint Jean.
Il place son infanterie au-dessus et en arrière du village
La 1e division : 31e de marche, 33e mobiles et 75e mobiles à gauche.
La 2e division : 38e de marche, 66e mobiles (ceux de la Mayenne dont un bataillon
a perdu √† Loigny dans trois attaques successives contre le ch√Ęteau de Goury
et la ferme de Beauvilliers les deux tiers de son effectif et les deux tiers
de ses officiers; régiment qui se distingua encore tout entier dans la défense
d'Orl√©ans autour de Vend√īme aux environs du Mans et √† Chassill√©) le 22e mobiles
et le 62e de marche à droite.
Le 40e de marche occupe le front de St Jean qu'il doit d√©fendre co√Ľte que
co√Ľte.
Toute la ligne est couverte par de nombreux tirailleurs qui s'abritent derrière
les haies et dans les fossés.
Il est 11h et demi, l'armée de Frédéric-Charles
se présente et engage l'action par un feu de mitrailleuses sans résultat appréciable.
A midi et demi les allemands font avancer une batterie qui n'est pas plus
heureuse. Elle est bient√īt suivie par une colonne d'infanterie accompagn√©e
de deux pièces.
Nos canons de 4 les obligent à se taire, pendant que nos mitrailleuses
arrêtent et dispersent leurs fantassins.
Alors l'ennemi met en position trois batteries en face de la route nationale
pour préparer la voie à ses profondes colonnes qui essaient vainement d'aborder
de front l'armée française; l'ennemi provoque un double mouvement tournant
qui est arrêté sur notre gauche par les mitrailleuses du capitaine Perret,
et sur notre droite par les mitrailleuses du capitaine Delahaye.
L'ennemi qui en double colonne avait tenté d'enlever le pont de St Jean
au pas de course fut ainsi dispersé à trois reprises différentes.
Les prussiens établissent de nouvelles batteries et vomissent sur nos soldats
une grêle de projectiles.
Nos canons font rage pour leur répondre malgré leur
infériorité.
Impassible dans la mitraille, l'amiral Jauréguiberry avec le plus grand
sang froid donne ses ordres, dirige ses bataillons.
Il a son cheval tué sous
lui par un obus, qui, après avoir traversé le cou de l'animal, blesse mortellement
le chef d'état major général du 16e corps, le brave colonel Béraud.
L'amiral
tient bon toujours et les soldats électrisés par son exemple, ainsi que les
artilleurs en dépit de leurs pertes sensibles, repoussent partout les efforts
désespérés des prussiens étonnés, découragés.
Le combat dure depuis plus de cinq heures.
Quand le feu cesse, l'ennemi
a perdu plus de deux mille des siens et il renonce à enlever de haute lutte
une position si bien défendue.
La nuit arrive se sentant tourné par un ennemi nombreux, Jauréguiberry ordonne
la retraite sur Laval, mais nos fantassins qui se tiennent à distance laissent
prendre possession du bourg à ces malheureux prussiens qui se croient déjà
chez eux.
C'est alors que de tous c√īt√©s arrivent nos soldats fran√ßais pour
infliger à l'ennemi un dernier combat et en faire dans le bourg même un véritable
massacre √† la ba√Įonnette.
Rappelons √©galement le combat √† la ba√Įonnette livr√© par les mobiles de la
Dordogne dans la maison même de la ferme de l'Epine. Tous les français présents
moururent jusqu'au dernier, une quinzaine environ.
Le combat de Saint-Jean ne finit qu'à huit heures du soir le 15 janvier.
Le
bourg était jonché de cadavres prussiens et le lendemain matin dés l'aube
on en retrouvait plus un.
Si les débris de la deuxième armée de la Loire ont
pu regagner Laval pour s'y r√©organiser et s'y reposer, c'est gr√Ęce √† la r√©sistance
du 16e corps à Saint-Jean-sur-Erve.
A la suite de ce combat les prussiens ont exigé de la population l'énorme
contribution de guerre de 20281F.
Pendant les dix sept jours qu'ils sont restés
à Saint-Jean-sur-Erve, les allemands ont fait des réquisitions de toute sorte
dont le total est évalué à 150000F au moins.
Pour perpétuer le souvenir, honorer le sacrifice et la vaillance des nobles
victimes françaises tombées au champ d'honneur pendant cette terrible journée
du quinze janvier 1871, pour rappeler à jamais l'exemple de ces braves soldats
français aux générations futures, un monument commémoratif a été élevé à la
limite du bourg, à la jonction des routes de Laval au Mans et de St Jean à
St Léger.
